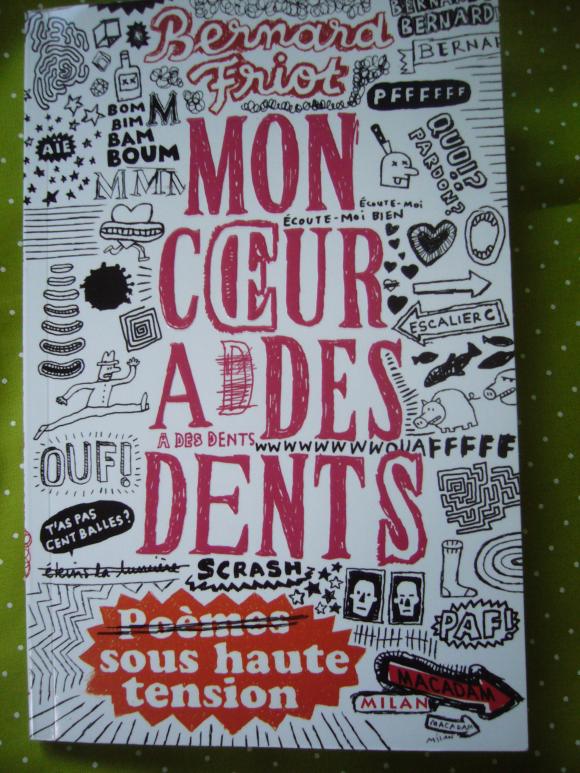

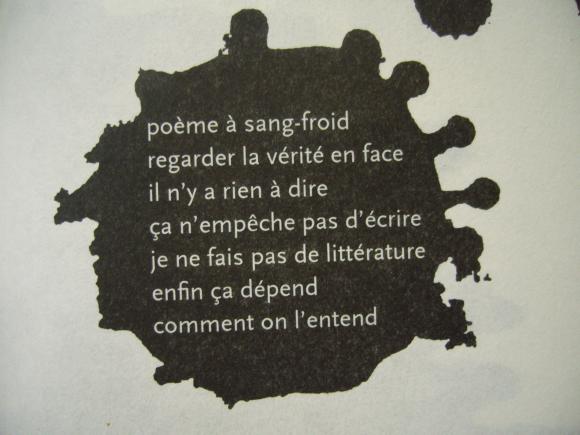

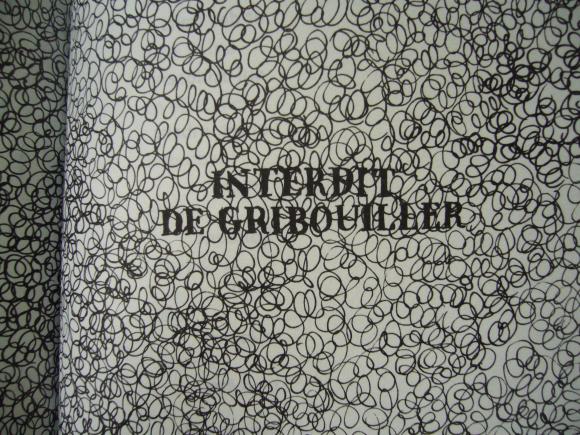

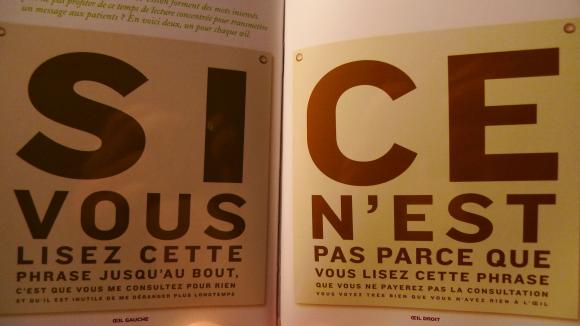

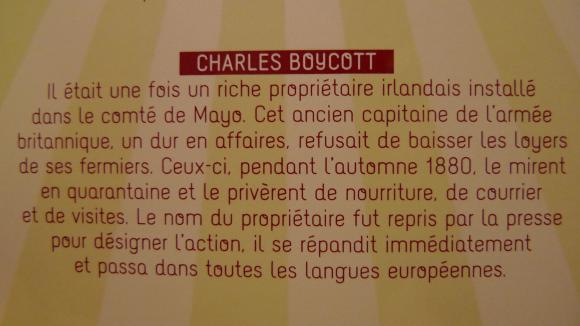
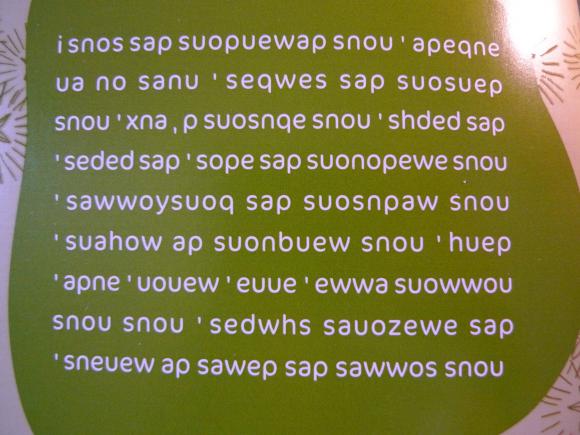
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, Et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. (MeL) (en images)
J'ai essayé d'expliquer à mes parents que la vie, c'était un drôle de cadeau. Au départ, on le surestime, ce cadeau: on croit avoir reçu la vie éternelle. Après, on le sous-estime, on le trouve pourri, trop court, on serait presque prêt à le jeter. Enfin, on se rend compte que ce n'était pas un cadeau, mais juste un prêt. Alors on essaie de le mériter. Moi qui ai cent ans, je sais de quoi je parle. Plus on vieillit, plus faut faire preuve de goût pour apprécier la vie. On doit devenir raffiné, artiste. N'importe quel crétin peut jouir de la vie à dix ou à vingt ans, mais à cent, quand on ne peut plus bouger, faut user de son intelligence.
Sa peau avait un goût de petit beurre et d'huile sauvage, de quatre heures sur une plage. Au réveil, le nez dans ses cheveux, son odeur me serrait l'estomac sans que je sache si c'était l'amour ou la faim. J'aimais prendre mon petit déjeuner avec elle dans les miettes et les bises, les caresses qui collent. Elle me demandait: « Tu es content? » et ça me faisait plaisir qu'elle ne me dise pas « heureux ». Je répondais la bouche pleine. Elle posait son oreille contre ma poitrine et elle disait « Ton coeur sonne occupé. »
Le long du hangar, en plein soleil.
Charles s’approche de Rodolfe.
CHARLES.- Je viens te dire adieu. Il faut que je parte, vite, avant qu’il ne soit trop tard.
Mais je ne pourrais pas partir sans t’avoir dit adieu.
RODOLFE.- Ferme ta gueule. Je suis déjà à demi sourd et tu me remplis les oreilles. J’ai
déjà entendu ce que j’avais envie d’entendre.
CHARLES.- Tu es à demi sourd et à demi aveugle pour tout le monde, mais je crois bien
que moi, tu m’entends et tu me vois, parce qu’avec moi, il n’y a pas besoin de ruse. Tu
sais, je suis aussi sourd que toi, aussi aveugle que toi pour tout ce qui nous entoure ici,
c’est pourquoi je veux partir quand je le peux encore. Mais à toi seul il fallait que je dise
adieu, toi seul aura entendu mon adieu et, sachant cela, je serai tranquille.
RODOLFE.- Je ne veux pas t’entendre, toi.
CHARLES.- Tu m’entendras quand même.
RODOLFE.- Qu’est-ce que tu veux exactement ? Je n’y vois pas grand chose et je n’entends
pas bien. Qui es-tu exactement ?
CHARLES.- Je suis ton fils, Charles, Carlos.
RODOLFE.- Je n’en sais rien et toi non plus, toi encore moins. Qui est-ce qui peut suivre les
pérégrinations de l’eau depuis la source jusqu’à la mer en étant sûr de ne pas se tromper ?
Je n’ai aucune raison de perdre mon temps à t’écouter.
CHARLES.- Aide-moi à partir. Je n’ai pas encore fait de mal qui mérite une punition ; est-
ce que tu trouverais juste, toi, qu’à l’âge où j’ai besoin de femmes pour les baiser, de
costumes à acheter, de voitures à conduire, à l’âge où je pourrais gagner de l’argent pour
tout cela, je continue à dépenser cet âge-là et cet argent-là à entretenir la mort d’une
vieille, et, quand elle mourra, il ne me restera rien à moi ? et à nourrir une fille pour des
garçons que je ne connais même pas et quand ils la ramasseront, fin prête, à moi, il ne me
restera plus rien, mon âge sera passé et mon fric en même temps ? C’est pourquoi je te
demande ta bénédiction comme tu m’as appris qu’un fils doit demander à son père quand
il quitte la maison.
RODOLFE.- Demande à ta mère et fous-moi la paix.
CHARLES.- Je ne veux rien demander à ma mère.
RODOLFE.- Tu as raison. C’est une chienne. Cette chienne profite de ce que je peux à
peine marcher et que je ne peux plus cracher que des demi-crachats. Cette sauvage
traînait dans le ruisseau ; c’est moi qui l’ai pêchée comme un têtard dans l’étang, qui l’ai
lavée et habillée, qui lui ai tout appris, comment marcher, manger, rire, pleurer, appris
que la terre était ronde et que le soleil tourne autour, appris une langue correcte elle qui
ne parlait qu’une langue obscène, appris la religion ; et une fois nourrie, habillée, sachant
cracher dans les crachoirs et se laver les doigts dans les rince-doigts, la sauvage s’est
réveillée en elle et elle s’est mise à travailler à mon malheur, sans raison, pour son foutu
plaisir de sauvage. Ainsi la pourriture gagne un fruit sain, mais jamais la santé ne regagne
un fruit pourri.
CHARLES.- Alors dons, tu penses qu’il est juste que je parte.
RODOLFE.-Rien du tout, je ne pense rien du tout, je suis beaucoup trop vieux et trop con
pour penser ; je veux seulement que tu me foutes la paix.
CHARLES.- Et moi ce que je veux, c’est ne pas être maudit ; je veux bien que tous me
condamnent, mais je sais que si toi tu as entendu mon adieu sans me maudire, je ne
tournerai pas toute ma vie sans pouvoir me débarrasser de cette condamnation, comme
ceux que leur père a maudits, c’est toi-même qui m’as appris cela.
RODOLFE.- De toute façon ta mère te maudira ; alors fous-moi la paix et tourne en rond.
CHARLES.- Je me fous de la malédiction de ma mère.
RODOLFE.- Tu as raison ; Les femmes maudissent le matin et bénissent tout d’un coup
pendant la nuit, et quand le matin se lèvent, elles remaudissent et bénissent encore une
fois à midi, c’est comme un vent qui souffle dans un sens et dans l’autre et laisse les
arbres tout droits. Mais ma malédiction à moi, elle est comme une poignée de sel que je
jetterai dans le thé , et rien ne pourra plus rendre le thé buvable.
CHARLES.- C’est pour cela que je ne veux pas que tu le fasses.
RODOLFE.- Je le ferai quand même, je le ferai quand même, compte sur moi.
CHARLES.- Pourquoi ? qu’est-ce que tu attends, encore ? Je te regarde et je vois que tu ne
peux presque plus marcher, que tu es à demi sourd et aveugle, que la vie t’a
complètement cassé, et que tu es vieux. J’admire l’homme fort, autoritaire, j’admire
l’homme de trente ans qui est autour de toi comme ton ombre, et dont je me souviens un
peu. Mais aujourd’hui cet homme-là n’est qu’une ombre, et ce qui existe vraiment, c’est
un homme vieux, brisé, dont les morceaux ne seront jamais recollés. Tandis que moi,
regarde-moi, les morceaux ne sont pas encore brisés, c’est ma vieillesse qui est autour de
moi comme une ombre, mais la réalité est encore solide. A toi, on ne peut plus te faire de
mal. Tu peux bien ne plus espérer conduire une voiture, tu peux bien ne plus t’inquiéter
de comment tu t’habilles, tu peux bien abandonner l’idée de baiser une femme. On ne
peut plus t’empêcher de faire cela, puisque tu ne le feras de toutes façons plus. Mais à
moi, on peut encore me faire du mal. Et si l’avenir a pitié des vieillards et les oublie, les
vieillards peuvent bien avoir pitié de ceux que l’avenir guette comme une ennemi.
RODOLFE.- Je ne comprends rien à ce que tu dis, la guerre et la vieillesse m’ont rendu à
demi débile, je ne sais même plus exactement qui je suis, alors qu’est-ce que tu viens me
réclamer, à moi ?
CHARLES.- Tu es mon père, que tu le veuilles ou non, et cela, ta vieille cervelle ne peut
pas l’oublier.
RODOLFE.- Comment es-tu si sûr que je sois ton père, toi, alors que je ne le suis pas moi-
même ? De toute façon, les mères sont les papas et les mamans à la fois ; un père, c’est
comme une petite averse au-dessus de l’océan, pas le temps de voir où les foutues gouttes
ont filé. Et puis, je n’en ai rien à foutre.
CHARLES.- Alors, je veux, du moins, que tu te souviennes de moi. Seulement cela. Je veux
rester dans le souvenir de quelqu’un pour ne pas mourir, même dans le souvenir d’une
vieille cervelle comme la tienne. Cela, tu ne me le refuseras pas. Tu ne peux pas me le
refuser.
RODOLFE.- Bien sûr que je le peux. J’oublie tout, je n’ai plus de mémoire. D’ailleurs, je
t’ai déjà oublié.
CHARLES.- Pourquoi est-ce que tu veux mon malheur ?
RODOLFE.- Parce que je ne te veux rien.
Charles sort.